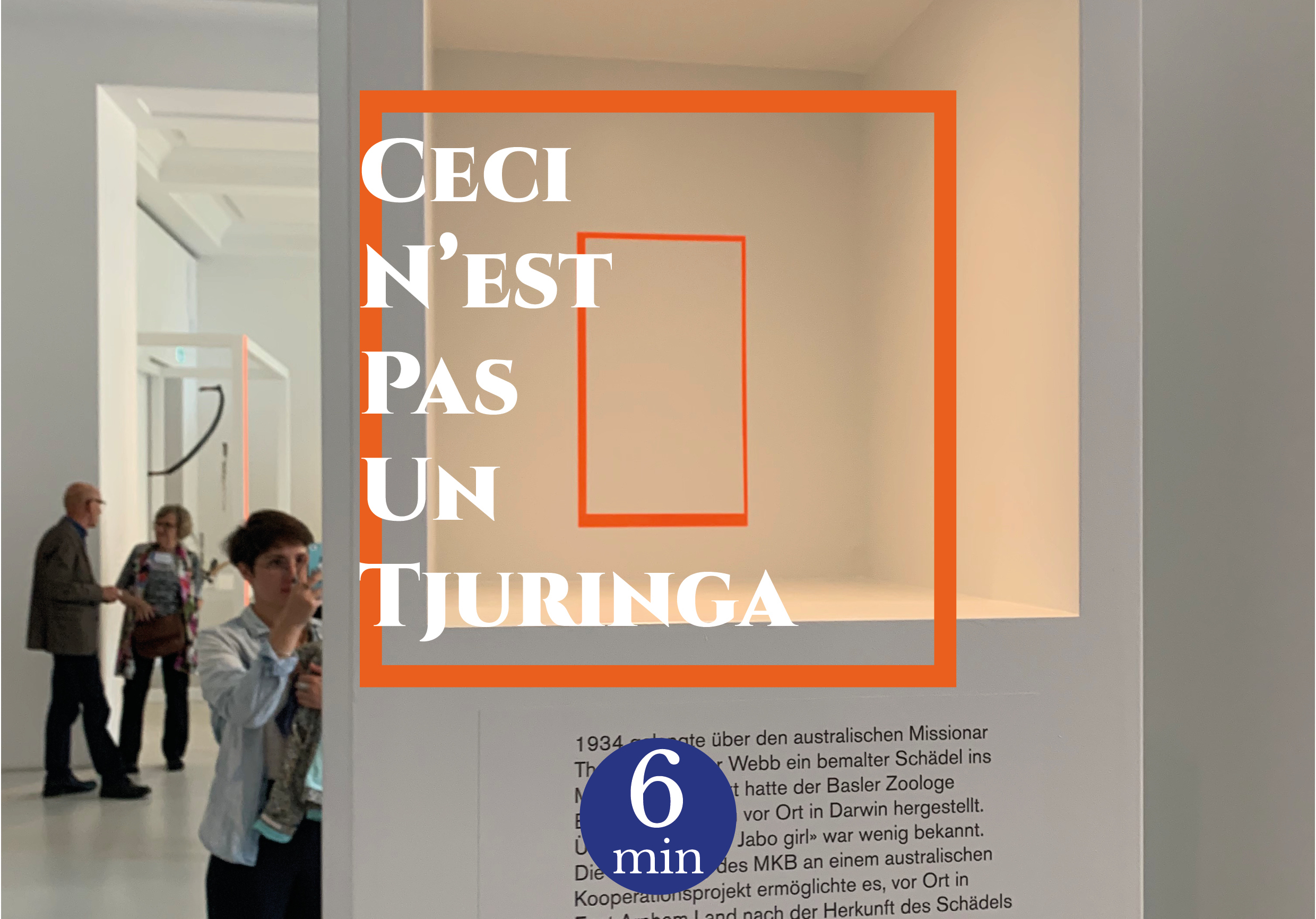« En 1967, nous avons été comptés, en 2017, nous cherchons à être entendus. »
En 1770, le capitaine Cook déclare l’Australie Terra Nullius (« territoire sans maître ») après avoir atteint Botany Bay à Sydney le 26 avril et en fait un nouveau territoire de la Couronne britannique qui est devenu par la suite une colonie pénitentiaire. Le 18 janvier 1788, la première flotte arrive à Sydney Cove avec les premiers bagnards. Depuis lors, l’Australie vit avec le mensonge d’une terre vide, malgré les 65 000 ans de présence continue des Australiens aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. En 1962, le droit de vote a été accordé aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres, mais le vote n’était pas obligatoire. Toutefois, le droit de vote n’a été pleinement accordé au niveau fédéral qu’en 1984, lorsque les autochtones d’Australie ont dû s’inscrire sur les listes électorales. En 1963, les Yirrkala Bark Petitions (littéralement, pétitions sur écorce de Yirrkala) sont présentées au parlement. C’est l’une des premières fois que les Aborigènes présentent un document pour la reconnaissance de leurs terres. Voir plus